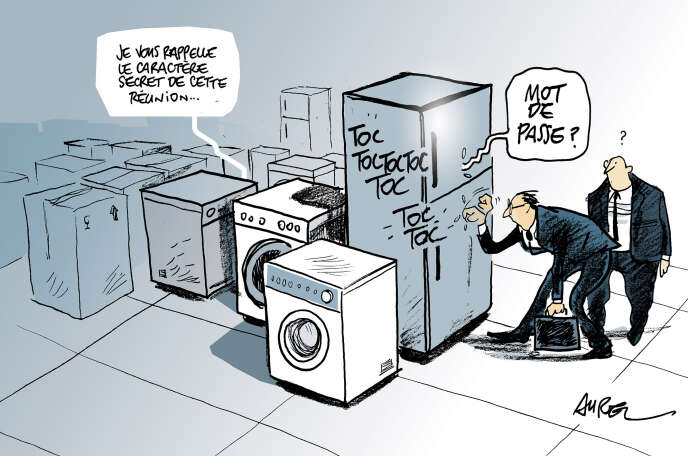La pandémie a certes détruit 255 millions d’emplois dans le monde en 2020. Mais elle a aussi relancé certains secteurs et enrichi les actionnaires d’Apple, de Netflix et d’Amazon.
Par Nicole Vulser, Alexandre Piquard, Jean-Michel Bezat, Aline Leclerc, Emeline Cazi, Juli…
Journal Le Monde, vendredi 5 février 2021.
Non, le nouveau coronavirus n’a pas tout asséché ni appauvri. La crise économique est sans nul doute planétaire et historique. L’économie française a plongé de 8,3 % en 2020, selon l’Insee. De surcroît, la récession a détruit 255 millions d’emplois dans le monde, d’après l’Organisation internationale du travail. Le marché de l’automobile est exsangue, et accuse un recul de 15 % aux Etats-Unis et de 25,5 % en France. Les avions sont immobilisés au sol, les salles de restaurant et de cinéma, vides.
Toutefois, l’année 2020 aura aussi été celle d’une boulimie de dépenses de loisirs numériques et d’une fièvre acheteuse en ligne, à la suite de profonds « changements de modes de consommation », observe Simon Borel, chargé de recherches à l’ObSoCo, société d’études et de conseil en stratégie. Cela tient d’abord aux modes de vie casaniers, à cette injonction de rester à la maison, dans ce « refuge » qui préserve et protège. « L’ultime champ de repli » où nos concitoyens « ont pu agir », relève le sociologue.
Le domicile est devenu un bureau, une école, un gymnase, une salle de cinéma, mais aussi un restaurant ouvert matin, midi et soir. Partout, le télétravail a dopé les ventes d’ordinateurs (+ 4,8 % en 2020, soit la plus forte croissance annuelle depuis dix ans dans le monde) et asséché les stocks de fauteuils de bureau chez Ikea.
Les hypermarchés ont été pris d’assaut. Cela a été « une année exceptionnelle », marquée par « une accélération inédite », reconnaît Didier Duhaupand, président du groupement Les Mousquetaires, à la tête d’Intermarché. Dans l’Hexagone, la vente de produits de grande consommation a progressé de 7,7 %, selon Kantar Worldpanel. Du jamais-vu.
Car la crise a mis hommes et femmes aux fourneaux. Ils ont confectionné des gâteaux et des pains (+ 57 % pour les ventes de levure), à l’aide d’un robot flambant neuf (+ 34 % pour les ventes de modèles multifonctions), et investi dans une boîte Pyrex (+ 30 %) pour transporter leur « gamelle » au bureau. Privés de salles de spectacles, les ménages se sont rabattus sur les téléviseurs. Des grands formats, surtout. Aux Etats-Unis, leurs ventes ont bondi de 19 %.
Le désœuvrement a aussi été le meilleur ami des éditeurs de bande dessinée (+ 9 % en France), de puzzles (+ 63 % entre janvier et novembre 2020 dans l’Hexagone), des fabricants de skateboard (+ 31 % aux Etats-Unis) et de consoles de jeux. Entre avril et décembre 2020, Nintendo a écoulé 24,1 millions de sa Switch et 31 millions d’exemplaires du jeu Animal Crossing : New Horizons, exutoire favori de nombreux confinés.
Marchés dopés
Les adultes se sont, eux aussi, offert de nouveaux jouets. Les ventes de machines à coudre se sont envolées de 70 % chez Singer, atteignant 380 000 unités en France, fin 2020. Black & Decker a également profité de cette petite victoire du « C’est moi qui l’ai fait pendant le confinement » : le chiffre d’affaires du spécialiste de la perceuse était en hausse de 19 % au quatrième trimestre 2020.
ManoMano, plate-forme de vente de produits de bricolage, a généré 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires l’an passé, soit 20 % de plus que prévu. Les enseignes de bricolage (+ 4,8 %) et les jardineries (+ 8,1 %) ont bénéficié du « repli sur soi », analyse Laurence Paganini, présidente de la fédération du commerce spécialisé, Procos.
Les consommateurs ont passé plus de temps sur leur smartphone. Pour prendre des nouvelles et rire, en dépit de l’actualité. Plus de 2,6 milliards de personnes utilisent quotidiennement Facebook, WhatsApp et Instagram, soit 15 % de plus que fin 2019. L’activité du groupe de Mark Zuckerberg a augmenté de 33 % de septembre à décembre.
En ville, la crainte d’être contaminé dans un métro ou un bus a soutenu les ventes de vélo, électriques surtout (+ 20 % prévus en 2020)
Le confinement, la peur, l’angoisse d’être emporté par la pandémie de Covid-19 ont dopé nombre de marchés. A l’automne, 1,7 million de traitements supplémentaires d’anxiolytiques ont été prescrits par rapport aux prévisions initiales, d’après le rapport Epi-Phare en France rendu public à la mi-décembre 2020.
La mysophobie (crainte extrême de la saleté et des microbes) a, quant à elle, accéléré l’usage du sans-contact lors des paiements par carte bancaire et… les ventes de détergent et lessive chez Procter & Gamble (+ 12 %). En ville, la crainte d’être contaminé dans un métro ou un bus a soutenu les ventes de vélo, électriques surtout (+ 20 % prévus en 2020). « Le développement était déjà exponentiel, rappelle Virgile Caillet, délégué général de l’Union Sport & Cycle. La pandémie a accéléré la transition. » Car notre mode de vie à l’ère du Covid-19 a validé des marchés déjà jugés prometteurs.
Les jeux de hasard en ligne progressent de 40 %, note la Française des Jeux. Et la livraison de repas à domicile aurait « gagné deux à trois ans de développement sur ses plans de marche initiaux », d’après Just Eat en France.
Plusieurs valeurs boursières battent des records
Le commerce en ligne a aussi été placé sur orbite. Faute de pouvoir faire du lèche-vitrines, les consommateurs se sont rués sur Internet. En France, le Web représente désormais 13,4 % des ventes, rapporte la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, grâce au bond de 32 % des achats de produits physiques. Soit 112 milliards d’euros au total.
La Toile a recruté partout de nouveaux adeptes : au Brésil (+ 66 %), au Mexique (+ 54 %), en Russie (+ 45 %), mais aussi en Inde (+ 28 %), observe Euromonitor International. Les transporteurs, les fabricants de carton et, bien sûr, Amazon en ont fait leur miel. Pour la première fois depuis sa création, en 1994, le site de Jeff Bezos a généré plus de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours d’un trimestre. L’américain a clos l’exercice 2020 sur 320 milliards d’euros de ventes (+ 38 % par rapport à 2019).
Les mesures de confinement ont fait « tomber des barrières » sur le marché de la visioconférence, juge Gilles Bertaux, cofondateur de Livestorm, le spécialiste français. Ce média s’est imposé aux employeurs, aux salariés, aux écoliers et aux étudiants. Résultat : la société organise 40 000 événements par mois. Son concurrent, Zoom, revendique près de 400 000 entreprises clientes de plus de dix employés. Son chiffre d’affaires devrait quadrupler, à plus 2 milliards d’euros en 2021.
La « visio » payante entre aussi dans les mœurs, pour un cours de yoga ou une consultation médicale. Pas moins de 19 millions d’actes réalisés en téléconsultation ont été remboursés par la Sécurité sociale en 2020, dont 8 millions par le biais de Doctolib. Le verrou psychologique de l’abonnement en ligne à un service a sauté.
Apple revendique désormais 620 millions d’abonnements, soit 140 millions de plus que fin 2019. Netflix, lui, en affiche plus de 200 millions dans le monde (+ 31 % en un an), avec des revenus avoisinant 25 milliards de dollars (20,8 milliards d’euros, + 24 %). Vingt-trois ans après sa création, le site de films et séries approche du seuil de rentabilité.
Aucun de ces phénomènes n’a échappé à la Bourse. En dépit de la crise économique, plusieurs valeurs, soutenues par la politique très accommodante des banques centrales, battent des records. A commencer par Apple. L’américain a réalisé le plus gros bénéfice trimestriel jamais enregistré par une entreprise privée : 23,8 milliards d’euros fin 2020. La firme pèse dorénavant 2 300 milliards de dollars en Bourse.
De nombreux investisseurs se sont enrichis
Le contexte pandémique n’a pas non plus empêché les levées de fonds. Fin 2020, Livestorm a levé 25 millions d’euros. Chez Deliveroo, le montant est encore plus spectaculaire : après avoir bouclé un tour de table de 180 millions de dollars mi-janvier 2021, le britannique vaut désormais 7 milliards de dollars. La plate-forme de livraison se délecte de la fermeture des restaurants : elle a décroché le référencement de 46 000 restaurants, dont la plupart ont été privés d’activité. L’entreprise qui fait rouler 110 000 livreurs file tout droit vers une entrée en Bourse, dès avril. Ce sera au bénéfice de ses actionnaires, des fonds d’investissements, surtout, et… d’Amazon.
Les sociétés pharmaceutiques ont tiré le meilleur parti de 2020. Du moins celles qui se sont positionnées avec succès sur le vaccin contre le Covid-19
De fait, la crise a déjà enrichi moult investisseurs, à l’image des actionnaires de Spotify. La capitalisation boursière du champion du streaming musical a doublé, pour atteindre 65 milliards de dollars, à la faveur de la hausse du nombre d’abonnés (+ 24 %, à 155 millions).
DocuSign fait aussi partie des gagnants. Le leader mondial de la signature électronique (solution sécurisée lors de la conclusion de contrats à distance) a vu son activité franchir le cap du milliard de dollars. Son cours de Bourse a explosé : + 188 % en un an.
Sans surprise, les sociétés pharmaceutiques ont également tiré le meilleur parti de l’année écoulée. Du moins celles qui se sont positionnées avec succès sur le vaccin contre le Covid-19. Moderna, dont le vaccin est autorisé dans l’Union européenne depuis le 6 janvier, dépasse les 60 milliards de dollars de capitalisation boursière. Lonza, son sous-traitant suisse, en profite : son bénéfice net a connu une hausse d’environ 35 % en 2020.
Au fil de l’année, le cours de la firme allemande BioNTech, qui a développé avec Pfizer un vaccin à ARN messager, a bondi de 250 %. La fortune de son PDG, Ugur Sahin, s’élève aujourd’hui à plus de 5 milliards de dollars, à en croire Bloomberg. Albert Bourla, directeur général de Pfizer, s’est aussi largement enrichi, lors de la vente de 5,6 millions de dollars d’actions du laboratoire, le 9 novembre 2020, jour de l’annonce de bons résultats préliminaires de son vaccin. Depuis, le groupe estime que celui-ci devrait générer 15 milliards de dollars de ventes en 2021.
Si les actionnaires de ces entreprises se frottent les mains, qu’en est-il de leurs salariés ? Ont-ils aussi bénéficié de la crise ? Chez Black & Decker, le PDG a adressé un message de remerciement à « chacun » des 53 000 employés pour leur « performance héroïque » et leur a accordé… un jour de congé, lundi 1er février. « On l’a pris », déclare Pierre Rousseau, représentant CFDT au comité européen du groupe, et délégué central des usines françaises, en soulignant qu’« il est certain que les salariés auraient préféré une prime ou une augmentation de salaire ». Un sentiment largement partagé, après une année si particulière.
Multiples controverses
Car les représentants du personnel sonnent régulièrement l’alarme. En entrepôt, par exemple, les cadences ont été infernales. Le syndicat SUD note combien les postiers ont été « rincés » par l’explosion du nombre de livraisons assurées par La Poste fin 2020, avec près de 4 millions de colis par jour en France. Depuis l’irruption de la pandémie, l’emballement de la « gig economy », cette économie de petits boulots précaires que symbolisent les livreurs Deliveroo ou Uber Eats, soulève de multiples controverses.
Just Eat, qui jure prôner un modèle social plus responsable, annonce vouloir recruter 4 500 livreurs en CDI en 2021 dans l’Hexagone. Amazon veille aussi à son image. Accusé au printemps 2020 de ne pas avoir suffisamment protégé ses employés, le site américain a augmenté leur salaire de 2 euros de l’heure, d’avril à juin, puis distribué une prime d’été de 500 à 1 000 euros, et, enfin, reconduit une prime de fin d’année liée au pic d’activité des fêtes.
Chez Seb, la prime dite Macron a été versée en deux fois à près de 3 900 des 6 000 employés français. Et pour faire face à la hausse d’activité dans ses usines hexagonales et l’envolée de la demande de yaourtières (+ 26 %) et de machines à pain (+ 39 %), le groupe a accordé une prime de 15 euros par jour à ses salariés, entre mars et juin 2020. Au premier trimestre 2021, une « centaine d’intérimaires seront embauchés en contrat à durée indéterminée », précise son directeur des ressources humaines, Dan Abergel.
Le secteur de la vente en ligne embauche aussi à tour de bras. En France, ManoMano va signer 350 recrutements en 2021, après 200 en 2020. Fin 2021, le site emploiera plus de 1 000 personnes. Amazon, lui, a déjà recruté 400 000 personnes entre janvier et octobre 2020, soit plus de 1 300 par jour en moyenne, dans le monde. L’e-commerçant, qui fait travailler 1,15 million de salariés, figure parmi les premiers employeurs des Etats-Unis, aux côtés de Walmart (2,2 millions). Signe que le Covid-19 n’a pas fini de bousculer le monde de l’entreprise.